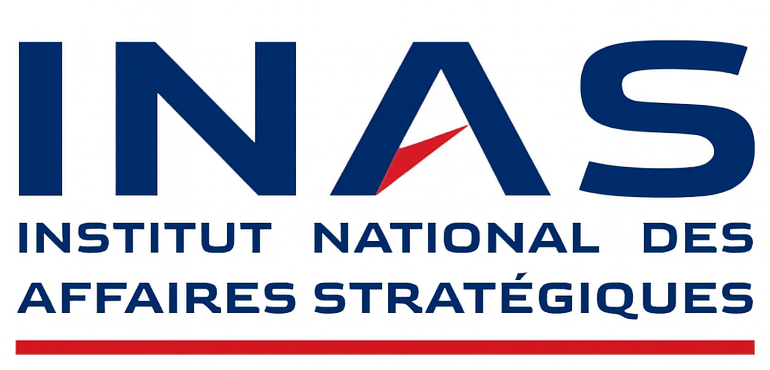Dans ce climat d’incertitude politique, la zone économique exclusive et l’extension territoriale du plateau sous-marin restent un sujet de tension avec l’Australie et le Vanuatu. C’est également le cas avec certains pays d’Asie du Sud-Est (par exemple la République populaire de Chine), très enclins à mener des actions de pêche en eaux profondes sans autorisation et sans respect des quotas. Toutes ces problématiques géostratégiques et géoéconomiques, liées aux énergies fossiles et aux ressources de pêche, constituent des enjeux stratégiques pour la France. Comme l’indiquait déjà Abdelkader Saïdi, de la Fondation Jean-Jaurès, en 2021, dans son article « Indépendance de la Nouvelle-Calédonie : quelles conséquences ? », la souveraineté nationale en mer, mais aussi l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, doivent faire l’objet d’une prise en compte politique lors du transfert de compétences au nouvel État associé de Nouvelle-Calédonie. Sans cette prise en compte, la métropole risque de voir ce territoire ultramarin tomber sous l’influence d’autres États (par exemple l’Australie, la Chine ou les États-Unis). Cet état de fait a déjà pu être constaté en juillet 2023, après que l’Azerbaïdjan a réuni, d’initiative et sans consultation de la France, les groupes indépendantistes de plusieurs territoires ultramarins français. Ce congrès a eu pour objet la création d’un « front de libération » par les indépendantistes des territoires ultramarins. Cette réunion avait d’ailleurs pris le titre de « congrès des colonies françaises ». L’intention, sans équivoque, de Bakou est de faciliter l’indépendance de ces collectivités et de créer un partenariat politique et économique favorable à l’Azerbaïdjan. Une implication supranationale manifestement favorable à l’indépendance totale des territoires ultramarins français n’est pas propice à un apaisement des tensions entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie. Malgré l’accord de Bougival, qui élargit potentiellement les pouvoirs accordés aux institutions calédoniennes, une partie de la population kanak considère que cet accord ne va pas assez loin dans le transfert de compétences de la métropole vers leur territoire.