Début mai 2025, la Chine lance la nouvelle génération de son processeur quantique Zu Chongzhi-3 (103 qubits), dont les performances se mesurent à son homologue américain Willow (105 qubits) de Google AI. Cet événement, loin d’être isolé, témoigne que les technologies quantiques, initialement cantonnées à la recherche fondamentale, pourraient constituer un levier stratégique majeur, par la remise en cause des fondations de la sécurité numérique, particulièrement en matière de cryptographie et de communication. Dans ce secteur de plus en plus contesté, une question se pose : après avoir dressé un état des lieux des technologies quantiques, cet article entend examiner les différentes approches de coopérations européennes qui pourraient constituer une piste pertinente face aux menaces émergentes susceptibles d’être causées par ces mêmes technologies
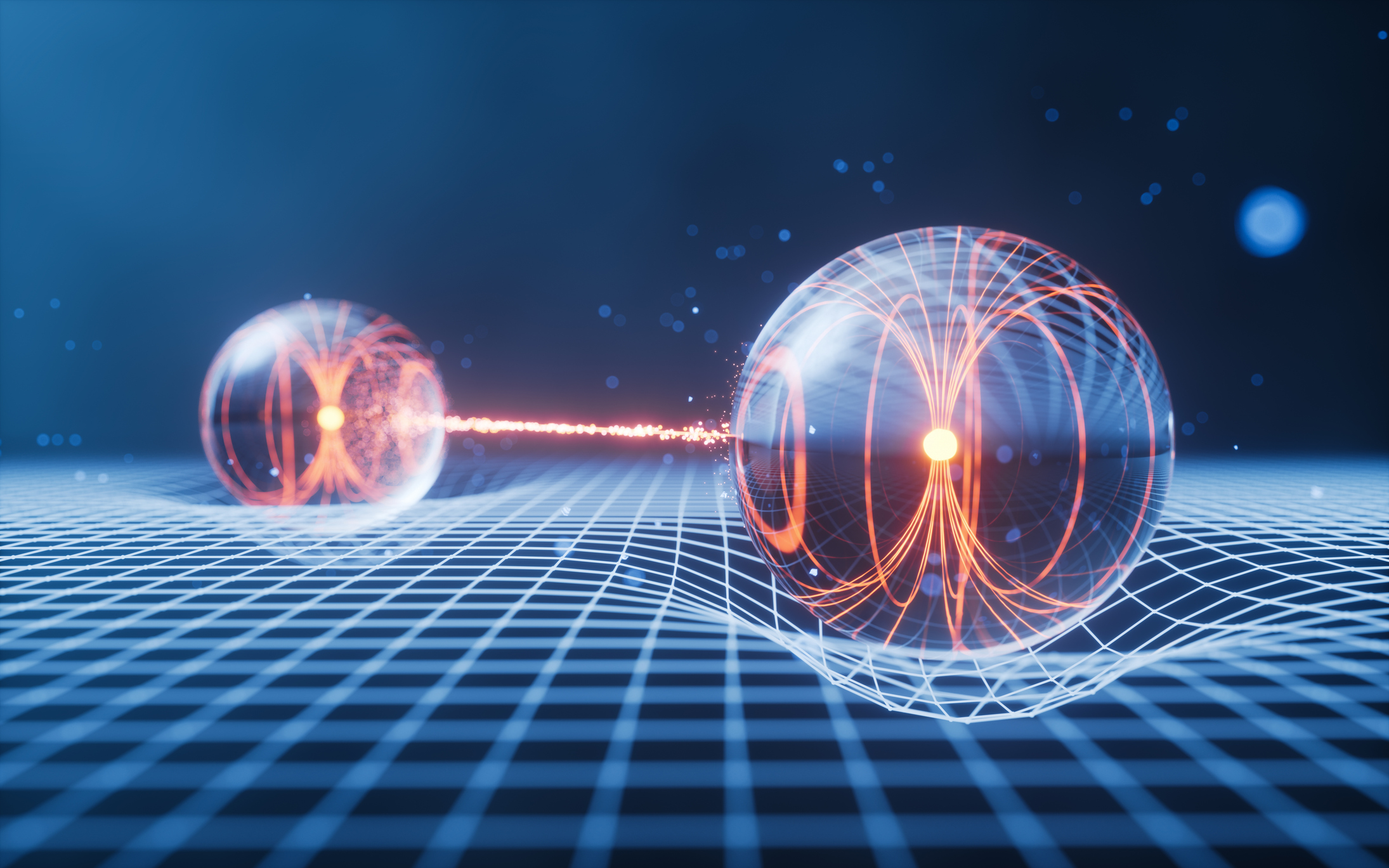
Les technologies quantiques (TQ) ont dévoilé leur potentiel disruptif suite aux travaux de Peter Shor, qui a démontré dès 1994 la capacité d’une suite d’opération logique à casser les algorithmes de cryptographie asymétrique (RSA, ECC), en exploitant les principes de superposition et d’intrication (OPECST – 2019).
Considérant que le degré de maturité technologique global des TQ demeure naissant (TRL 3-4), certains segments tels que les communications sécurisées atteignent déjà un niveau autour de 6-7, par l’existence de démonstrateurs en condition réelle. En conséquence, une menace systémique future pèse sur les infrastructures des États, car les capacités des TQ pourraient remettre en cause le paradigme de sécurisation des clés publiques traditionnelles (Arthur D. Little – 2023).
La principale menace quantique réside dans le scénario « store now, decrypt later ». Des données interceptées aujourd’hui pourraient être stockées, puis décryptées, dès l’apparition d’un ordinateur quantique à capacité de rupture (CRQC), exposant ainsi les infrastructures critiques n’ayant pas migré à temps vers des systèmes résistants au quantique tels que les services publics et l’armée (BSI – 2023). La cryptographie post-quantique (PQC) est une solution orientée logicielle, interopérable avec les systèmes existants et peu coûteuse à déployer, mais sa robustesse future face à une cyberattaque quantique reste théorique.
La « Distribution Quantique de Clés » (QKD) quant à elle, repose sur les lois de la physique quantique pour sécuriser les échanges, et empêcher toute interception. Elle est cependant très coûteuse et nécessite des infrastructures matérielles dédiées. La stratégie européenne quantique repose sur la complémentarité de ces deux approches. Tandis que la PQC permet de sécuriser rapidement les systèmes actuels, la QKD, elle, vise à construire un socle souverain de communication ultra-sécurisée pour les secteurs sensibles comme la défense. L’objectif ultime consiste à établir un internet quantique (CEPS – 2025).
Face à ces enjeux, la coopération industrielle est guidée par trois Etats notamment : la Chine, le leader, qui concentre 50 % des investissements publics mondiaux en quantique (~15 Mrd $). Elle dispose d’une trentaine d’acteurs majeurs (Alibaba, TuringQ) et a lancé dès 2016 le satellite « Micius », pionnier de la QKD spatiale sur plus de 1000 km dans le cadre du projet « Quantum Experiments at Space Scale » (QUESS) avec l’Autriche.
La Corée du Sud, quant à elle, a lancé en 2022 le « National Convergence Network Project » (NCNP), reliant 48 institutions via un réseau QKD de 800 km, en partenariat avec SK Broadband (télécommunication) et ID Quantique (cybersécurité). Singapour, avec le projet « NQSN+ » depuis 2023, suit une approche européenne, en développant des bancs d’essai préalables au déploiement d’un réseau sécurisé à usage gouvernemental, en collaboration avec Singtel, SPTel et SpeQtral (connectivité quantique) (SIR 2025).
L’Union européenne a lancé plusieurs initiatives structurantes autour de la « Distribution Quantique de Clés » (QKD), en particulier « EuroQCI » (2019), visant à construire un réseau de communication quantique pan-européen ultra-sécurisé.
Conduit par la Commission européenne en collaboration avec l’ESA, « EuroQCI » repose sur un réseau hybride combinant un segment terrestre (fibre optique) et spatial (liaisons satellites quantiques). L’ESA pilote notamment le développement du segment spatial via son programme « Security And cryptoGrAphic mission » (SAGA). Plusieurs consortiums ont été créés, notamment « PETRUS », chargé d’harmoniser les déploiements nationaux et l’interopérabilité des systèmes (SIR 2025).
Dans cette dynamique, la France a lancé « France QCI », un projet pilote coordonné par Orange, avec Thales et Airbus, pour tester en conditions réelles un réseau QKD national en vue d’un déploiement européen (Consortium PETRUS).
L’écosystème industriel européen, hétérogène, est composé de startups innovantes (Quandela, Quside) et de grands groupes (Thales, Leonardo), concentrés en Europe de l’Ouest (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni).
Cette concentration crée un pipeline d’innovations fragmentées, aggravé par le manque de capitaux des petites et moyennes entreprises (PME) pour passer de la preuve de concept à la mise à l’échelle commerciale, freinées par les délais de développement et l’accès au financement (Télécom Paris – 2025). Malgré la publication d’une feuille de route industrielle commune en 2025 (SIR), les divergences nationales dans les priorités scientifiques ralentissent l’élaboration d’un agenda européen cohérent. À titre d’exemple, la France reste réservée quant à l’usage de la QKD (A. Rodriguez – 2025).
La France joue un rôle actif dans la diplomatie quantique. En avril 2025, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a signé un accord de collaboration (MoU) avec le Bureau national du quantique de Singapour pour coopérer sur la photonique quantique (FCCS – 2025).
Elle participe aussi à des projets structurants, comme le partenariat tripartite avec l’Allemagne et les Pays-Bas ($33 M), réunissant acteurs scientifiques et industriels (Orange Quantum Systems, CNRS) pour encourager les synergies technologiques. Toutefois, ses investissements restent modestes comparé à certains de ses compétiteurs européens ($2,2 Mrd contre $5,2 Mrd en Allemagne et $4,3 Mrd au Royaume-Uni). (Chouchair – 2025) – (CSIS – 2023).
Connecter opérationnellement les réseaux nationaux via une infrastructure commune passe par l’accélération des tests de validation des technologies QKD développées dans le cadre d’EuroQCI. Les démonstrations en conditions réelles au sol (fibre) et surtout dans l’espace (liaisons satellites) semblent essentielles, car les réseaux satellites offrent une portée bien supérieure aux réseaux terrestres (QuIC – 2025).
Un sous-projet notable de coopération à travers EuroQCI, entre la Commission européenne et l’ESA a conduit au développement du satellite Eagle-1, prévu pour 2026 (piloté par SES et 20 partenaires européens), dont l’objectif est de prouver la fiabilité de la transmission de clés quantiques sécurisées depuis l’espace vers les infrastructures critiques européennes (armées, institutions…). (Hiemstra et al – 2025).
L’Europe dispose d’une base industrielle prometteuse, qu’il s’agit de consolider pour réduire sa dépendance technologique. Cela implique de soutenir des filières stratégiques comme les semi-conducteurs et la photonique à travers des initiatives telles que Qu-Test, Qu-Pilot ou Chips-JU, qui aident à structurer une chaîne de valeur européenne.
Il semble également nécessaire de favoriser l’émergence de champions européens, en les protégeant contre les rachats, via un cadre juridique harmonisé entre États membres. Cela faciliterait les fusions intra-UE. Favoriser aussi la diplomatie quantique avec des partenaires stratégiques (Canada, Japon, Corée du Sud), permettrait d’encourager la mobilité des talents et les investissements (QuIC – 2025).
La souveraineté technologique européenne implique de dépasser les divergences nationales sur la coopération stratégique. Une stratégie commune semble nécessaire pour aligner les stratégies nationales et faciliter les efforts conjoints de R&D quantique.
À ce titre, la nouvelle Vice-présidente de la Commission européenne à la Souveraineté technologique, Henna Maria Virkkunen, a défendu une vision forte en annonçant une “stratégie quantique unifiée” pour remédier à la fragmentation actuelle. Cette stratégie, en lien avec les cadres existants (Chips Act) pourrait poser les bases d’un futur Quantum Act, garant d’une Europe plus compétitive et souveraine (QuIC – 2024).
Le risque associé à l’émergence d’un CRQC bien que perçu comme lointain, représente une menace systémique pour la sécurité numérique des nations. En réponse, la Chine comme l’Europe multiplient les projets de coopération autour des approches PQC et QKD, pour assurer leur souveraineté numérique.
Dans cette course, l’Europe porte plusieurs initiatives ambitieuses, à l’image du programme EuroQCI, visant à se doter d’une infrastructure de communication quantique hybride, à la fois terrestre et spatiale. Néanmoins, les divergences nationales et les contraintes de financement freinent l’opérationnalisation d’une Europe du quantique.
Assurer l’interopérabilité des communications tout en consolidant les filières industrielles à fort enjeu stratégique pourrait constituer une voie prometteuse. Mais cela suppose une gouvernance européenne portée par la Commission européenne, capable d’enclencher une stratégie quantique unifiée, essentielle à la compétitivité technologique de la région.
Maxime Serie, Analyste au sein de la Commission des Coopérations Industrielles Technologiques de l’INAS
L’INAS a pour mission de contribuer au débat public sur les questions stratégiques. Ses publications reflètent uniquement les opinions de leurs auteurs et ne constituent en aucune manière une position officielle de l’organisme.
Pour aller plus loin :
© 2025 INAS